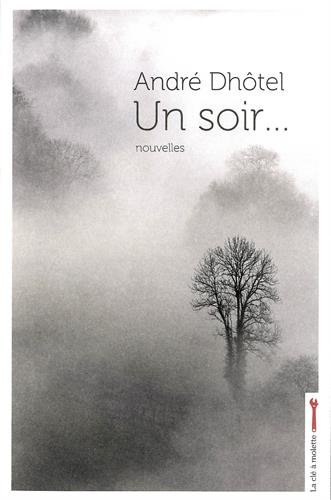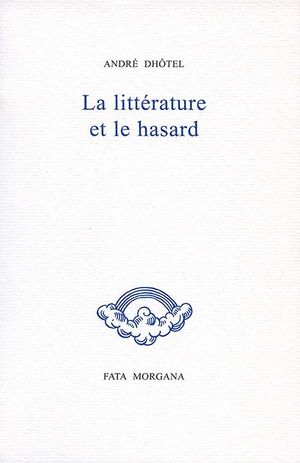Views: 1
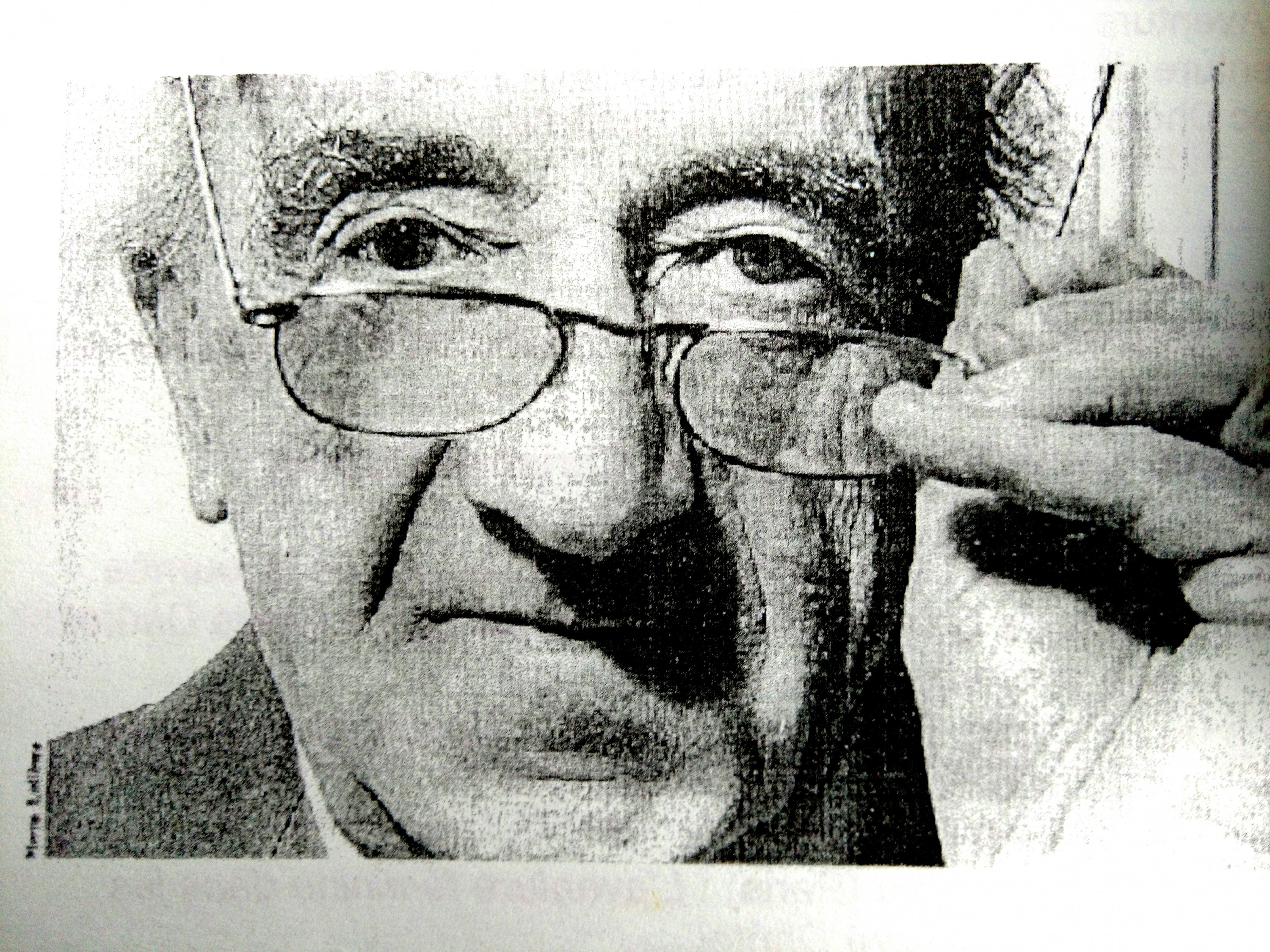
André Dhôtel
Je ne suis pas un lecteur patient, et je n’ai aucun titre pour entreprendre cette discussion ou cette histoire. Je devrais me fier entièrement à ceux qui ont poursuivi des études savantes alors qu’il est question d’apprécier dans la mesure du possible la valeur de telle œuvre singulière et ce que signifie la littérature. Ces critiques, ces écrivains, m’ont aidé, guidé et nourri sans aucun doute. Je n’ai rien à corriger dans leurs jugements. Il m’a semblé seulement qu’entre le lecteur toujours muet et les patrons de la littérature (auteurs, législateurs) il restait beaucoup d’idées jamais exprimées, un malentendu fréquent, fondé sur des raisons bien faites, dûment enseignées, fermement établies, et justes, trop justes. Il manque à l’art littéraire le plus sûr une certaine forme directe. Cela est bien prouvé par l’égarement inaccoutumé qui règne dans ces matières. La poésie se trouve souvent décriée par les poètes eux-mêmes, dégoûtés de prononcer des paroles inefficaces. D’où ces tentatives extrêmes (baroques ou géniales) auxquels se sont livrés quelques écrivains depuis la fin du 19e siècle pour retrouver un art primitif. Mais le public dont je fais partie ne veut pas cela non plus. Ce que nous désirons c’est que la littérature nous apporte un vif plaisir, une étrange certitude, où se mêleraient l’audace, la clémence, l’émerveillement : une joie de vivre tels que nous sommes, et que le plus misérable ait le droit de participer à la beauté du monde décrit par les livres. Nous aimerions que chaque livre veuille donner à tous les hommes le droit à l’enthousiasme, à la paix du cœur.
André Dhôtel, La Littérature et le hasard, édition de Philippe Blondeau, Fata Morgana, 2015, pp. 45-46.
Ici le professeur de philosophie Dhôtel se rapproche curieusement de Georges Bataille (« un vif plaisir », « une joie de vivre ») pour s’en éloigner très vite (« la paix du cœur »). Le romancier refuse de polémiquer avec les sérieux universitaires ou avec les critiques, aussi bien qu’avec les écrivains savants. Son refus du partage des castes n’est pas une révolte, c’est un simple sourire, qui ne détruira aucune chaire, mais qui donnera un peu d’air au lecteur suffoqué ou offusqué par les exégèses.
Si l’enfant de Roche, malgré tous ses efforts, n’a pas réussi à échapper au culte du héros, du magicien, du saint ou du champion, son vague cousin d’Attigny semble avoir gagné son pari risqué : obtenir et garder un public sans le tenir à distance.