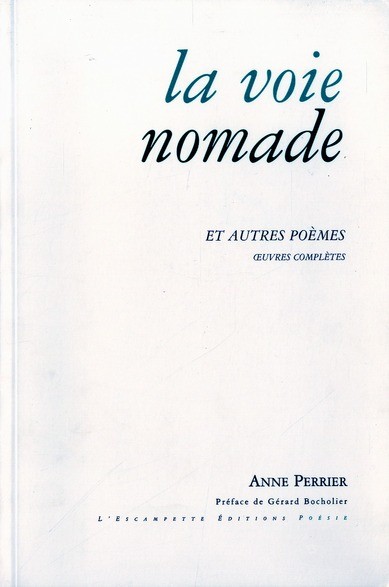Views: 0
Des moments d’une beauté unique
Anne Perrier 1922-2017

Anne Perrier, née à Lausanne le 16 juin 1922, est morte le 16 janvier 2017. Son oeuvre poétique est recueillie par les éditions L’Escampette en 2008.
Dans La Nouvelle Revue de Lausanne du 26 décembre 1967, quotidien auquel il collabora régulièrement de 1950 à 1970, Philippe Jaccottet écrit :
«Faut-il s’excuser de montrer des beautés de langage dans une poésie qui précisément ne les cherche pas, et qui n’est, intérieurement, qu’effusion de l’âme? Mais quoi? Si Anne Perrier n’avait ce don, toujours plus sûr, de choisir les images et les mots essentiels, d’associer les sonorité les plus persuasives, de rompre ou de presser le rythme, de s’arrêter au meilleur moment, elle pourrait être une sainte, elle ne serait pas poète, et l’élévation de son expérience nous resterait inconnue, ou nous serait communiquée par d’autres voies. Cela reste indéniable, même si, ce que je suppose, le travail d’Anne Perrier sur les mots ne ressemble pas du tout à celui de Mallarmé ou de Valéry, mais se fait «en dormant», c’est-à-dire dans le recueillement silencieux de l’être autour d’un seul désir et de quelques images.»
Note reprise in Ecrits pour papier journal Chroniques 1951-1970, Gallimard, 1994, p. 263.
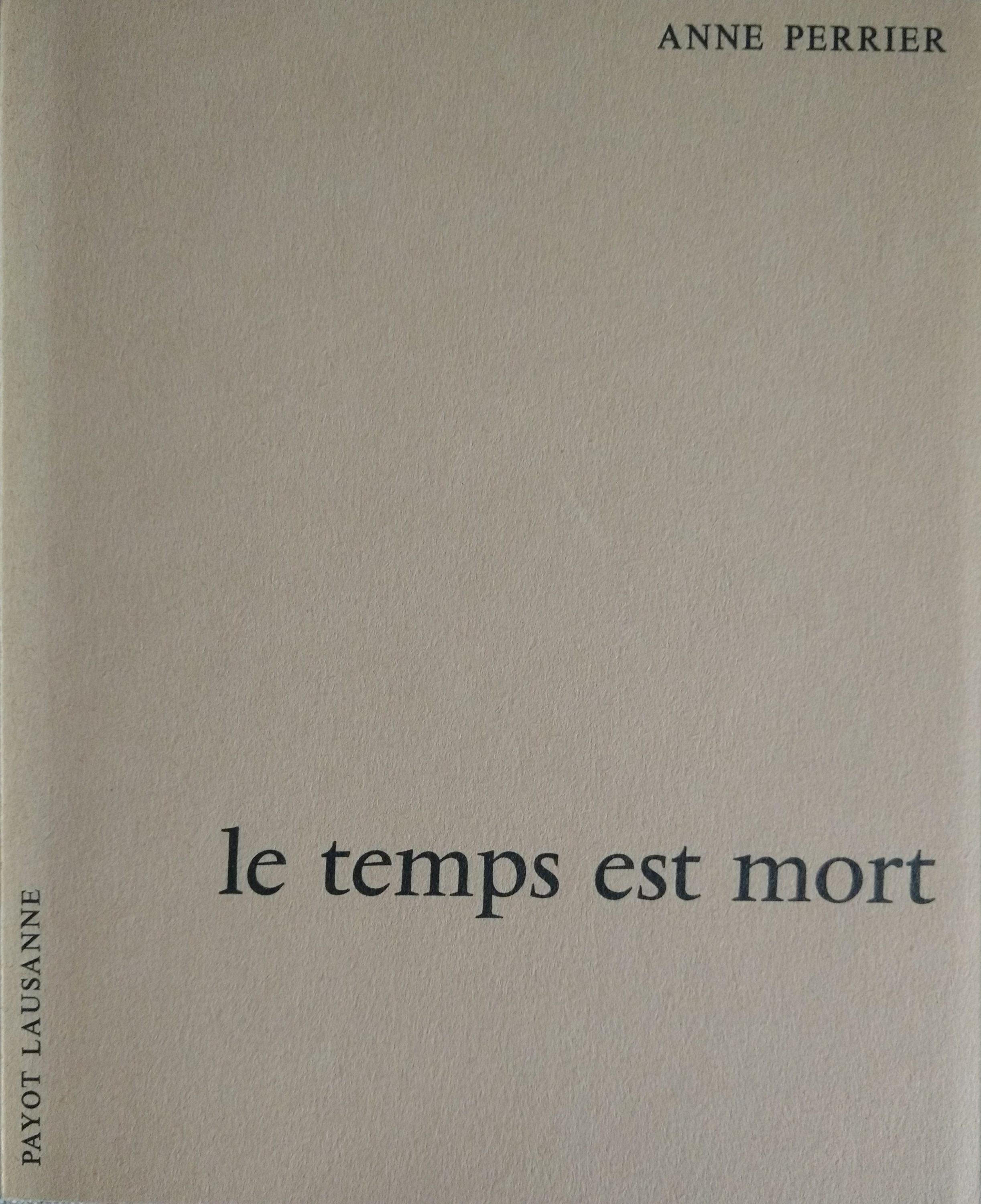
Jean Starobinski : «Pourquoi le public d’Anne Perrier ne cesse-t-il d’augmenter? Il suffit de lire, en donnant son attention. Cette poésie aiguë, sobre et limpide, occupe désormais une place distincte – très haut située – dans l’ensemble de ce qui paraît actuellement en langue française.»
José-Flore Tappy : «Proche des poètes mystiques mais aussi d’Emily Dickinson, dont elle aurait l’audace et la légèreté, la poésie d’Anne Perrier est tout entière tournée vers une écoute lucide du monde. Elle dit l’envol, toujours recommencé, qui va de l’«ombre humaine» à l’étincellement des oiseaux.»